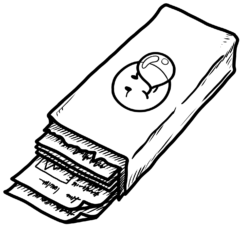Écriture : Jeanne Degortes
Relecture scientifique : Aurélien Schwob
Relecture de forme : Audrey Denizot et Eléonore Pérès
Temps de lecture : environ 15 minutes.
Thématiques : Histoire des sciences (Histoire), Écologie, Évolution (Biologie)
Publication originale : Bonneuil C., Seeing nature as a ‘universal store of genes’: How biological diversity became ‘genetic resources’, 1890-1940. Stud Hist Philos Biol Biomed Sci, 2019. DOI : 10.1016/j.shpsc.2018.12.002.

La diversité biologique — aujourd’hui mobilisée sous le terme de biodiversité — a connu diverses définitions et divers fondements au cours des découvertes scientifiques et techniques. Son acception actuelle est fondée sur la diversité génétique, considérée comme une ressource inventoriée et conservable dans un même endroit. Cette vision de la biodiversité a une histoire scientifique, politique et culturelle que nous proposons de retracer à partir d’une publication de Christophe Bonneuil de 2019, pour la période allant du 18e siècle à la Seconde Guerre mondiale.
Du monde naturel aux gènes : la construction scientifique de la biodiversité
Alors que la biodiversité est devenue l’un des mots-clés des politiques environnementales contemporaines, on oublie souvent que cette idée a une histoire. Une histoire où la nature fut longtemps pensée comme un capital à exploiter, un stock à répartir et parfois même un trésor impérial à conquérir. Aujourd’hui, tandis que les gènes se stockent dans des banques, se brevettent, s’échangent et se négocient dans des enceintes internationales, il vaut la peine de revenir au moment où l’on a commencé à regarder le vivant non plus comme un tissu de relations écologiques, mais comme un réservoir mondial de ressources. Comprendre cette généalogie, c’est éclairer les logiques économiques, politiques et coloniales qui continuent de façonner nos débats sur la gestion du vivant. C’est justement ce que Christophe Bonneuil propose dans sa publication de 2019 et que nous allons détailler ici.
Naissance d’une vision statique et abstraite de la nature : sociétés coloniales et industrielles du 18e siècle
La notion de biodiversité est aujourd’hui comprise comme la diversité des organismes vivants. Cela renvoie à la diversité des écosystèmes qu’ils constituent, à la diversité des espèces et à leur diversité génétique. Les gènes sont des segments d’ADN qui constituent le support des caractères que possède un organisme vivant. Par exemple, un caractère comme la couleur des fleurs de pétunia est codé par un gène [1]. Parmi ces caractères, certains sont identifiés comme avantageux pour des fins utilitaires, comme la résistance à la sécheresse. Ainsi, cela signifie que la compréhension actuelle de la biodiversité renvoie à la diversité des caractères. Les gènes, qui en sont au fondement, sont alors considérés comme une ressource à inventorier et à conserver.
L’origine de cette conception de la biodiversité et des gènes est liée à celle que l’on a de la notion de ressource. L’acception contemporaine des termes de stock, entendu comme un capital, c’est-à-dire une accumulation de richesses à des fins de production, et de ressource, au sens statique, a été acquise à la fin du 18e siècle. Auparavant, une conception plus dynamique et variable de la nature et des ressources qu’elle comprenait prédominait : elles n’étaient pas considérées comme immuables, sans changements, elles étaient donc plus difficiles à catégoriser. Mais le développement de théories économiques qui ont accompagné la révolution industrielle, comme celles d’Adam Smith, a impulsé un changement de définition vers une vision plus statique. En effet, la révolution industrielle se caractérise, entre autres, par le passage de l’utilisation d’énergies renouvelables à des énergies fossiles qui sont à la fois distantes de l’être humain physiquement (elles gisent profondément dans le sol) et temporellement (elles relèvent d’une temporalité géologique dépassant de loin celle que l’on peut humainement appréhender).
Ce contexte, ainsi que celui de l’expansion coloniale, favorisent une division entre d’un côté une société représentée comme dynamique et de l’autre une nature — à laquelle sont assimilés les terres et les individus colonisés — perçue comme lente, inerte, constituant un capital qui attend d’être utilisé et mieux réparti sur la planète par les colons européens. Dans ce double paradigme colonial et industriel, c’est autour de la catégorie fixe d’espèce que se cristallise la conception de la diversité de cette ressource qu’est devenue la nature. À ce titre, les espèces sont pensées comme pouvant être détachables de leurs lieux d’origine et des interactions avec les milieux dans lesquels elles évoluent et qui les ont façonnées.
Des espèces aux gènes : l’agriculture moderne et redécouverte des lois de Mendel sur l’hérédité au 19e siècle
La fin du 19e siècle s’accompagne de la redécouverte des lois de Mendel en biologie de l’hérédité sur la transmission et la distribution des caractères dans la descendance [*]. Cette redécouverte est liée aux enjeux de rentabilité dans l’élevage et dans l’agriculture. Les organismes vivants sont alors envisagés selon des variétés, reconnaissables par des traits discrets qui peuvent être isolés et recombinés. Les éleveurs et les biologistes s’intéressent davantage à un niveau infraspécifique, c’est-à-dire une sous-catégorie de l’espèce, comme une variété ou une sous-espèce, voire individuel pour la sélection généalogique (comme le pedigree d’un individu). En 1914, le généticien allemand Erwin Baur assimile la diversité biologique à la diversité génétique ; à l’époque, les gènes étaient compris comme des facteurs influençant le phénotype (= l’ensemble des caractères observables d’un individu) — et donc distincts de lui — mais pas encore pensés ou localisés au niveau moléculaire. Baur valorise les races anciennes pour leurs caractéristiques spécifiques comme la rusticité, la fertilité ou la résistance aux maladies. Il rationalise les anciennes pratiques de constitution de pedigrees, qui visaient surtout à documenter les lignées pour garantir la pureté ou certaines qualités visibles, et voit en la conservation de ces races patrimoniales une préservation de la richesse génétique qu’elles représentent, constituant un « réservoir » d’allèles rares pouvant être réintroduits dans l’élevage (des allèles sont des versions d’un même gène : pour le gène « couleur des yeux » on peut trouver différentes versions, marrons, verts, bleus, etc.).
Cependant, les procédés de modernisation de l’élevage par croisements de lignées contiennent le paradoxe de mener à leur propre perte, puisqu’ils conduisent à un appauvrissement de la diversité génétique — une pauvre diversité génétique rend en effet plus vulnérable aux maladies et réduit les capacités d’adaptation. Se pose alors l’enjeu de préserver et de conserver le matériel génétique de ces races locales pour assurer la pérennité des pratiques d’élevage.
Deux visions s’opposent. La première, soutenue par le secteur public et les petits fermiers, privilégie une conservation locale et décentralisée : elle cherche à maintenir la diversité des races adaptées à des territoires spécifiques et aux pratiques traditionnelles, même si certaines sont moins productives ou coûteuses à entretenir. La seconde, dite cosmopolite, portée par les semenciers et l’industrie agroalimentaire, promeut la scientifisation de l’élevage et l’uniformisation des techniques, en privilégiant des races ou variétés très productives et capables de performer dans de nombreux milieux, afin d’optimiser la rentabilité. La deuxième vision l’emporte et donnera lieu à des campagnes d’exploration pour le matériel génétique et des caractéristiques variées. Cette dynamique sera accentuée par la Première Guerre mondiale et les enjeux d’autosuffisance alimentaire que les pays rencontrent, auxquels répondent les promesses des scientifiques de nouvelles variétés plus productives et plus résistantes grâce à une richesse génétique provenant du monde entier.
Des gènes comme ressources impériales de l’URSS
Après la Première Guerre mondiale et dans un contexte néo-mendélien, les gènes sont ainsi devenus des ressources. Au début des années 1920, c’est en URSS, pays marqué par des sécheresses et par des tensions politiques, que la recherche en génétique est la plus développée. Ce contexte encourage le lancement par Lénine du Pan-Soviet Institute of Plant Industry, programme qui a comme double objectif d’améliorer les rendements agricoles et de fournir les républiques situées au sud de l’URSS en céréales. Cela passe par la sélection des cultures, par l’exclusivité forcée de la production soviétique avec ces semences issues de ce programme de recherche gouvernemental et par des prospections et la collection de semences, une véritable chasse destructrice à travers le monde entier. En d’autres termes, l’autoritarisme de l’État soviétique se développe et s’appuie sur la modernisation agricole, sur l’expansion massive de la production et sur l’imposition par la force de pratiques aux cultivateurs.
Les héritiers scientifiques de Mendel, en particulier les généticiens Nikolai Vavilov et Aleksandr Serebrovsky, se saisissent de ce climat pour développer la génogéographie, c’est-à-dire l’étude de la distribution des gènes sur la surface du globe, et pour déployer un réseau de stations et de sites de collection. Depuis la diffusion et l’acceptation des théories évolutives de Charles Darwin, les espèces ne sont plus considérées comme immuables, mais dynamiques dans le temps, notamment soumises au processus de sélection naturelle.
Ce cadre intellectuel ainsi que le développement de la génogéographie modifie la vision statique que portaient les stocks de gènes, et amèneront Vavilov à élaborer la notion de centres d’origine des plantes cultivées. Ce concept réfère à une concentration importante de formes (sous-espèces, variétés, races) qui coexistent dans un même lieu, et dont, à mesure qu’on s’en éloigne, les variations au sens darwinien du terme vont être plus fréquemment observées. En d’autres termes, il s’agit du berceau génétique d’une espèce, où, pour une plante par exemple, on trouverait une concentration de variations de taille et de forme des feuilles, alors qu’à mesure que l’on s’éloigne de ce centre, les groupes de plantes tendent à devenir plus homogènes, et les différences entre individus de différents groupes sont plus marquées par rapport aux formes originelles, reflétant l’adaptation à de nouveaux environnements ou à de nouvelles pratiques culturales.
Les centres d’origine nourrissent un récit génético-orientaliste, croisant un discours sur l’origine de l’agriculture et des sociétés humaines : les deux évolueraient du centre vers les périphéries en laissant se révéler des caractères plus précieux. Ces caractères sont fondés sur des gènes portant des allèles qualifiés de récessifs, qui n’avaient pas l’occasion de s’exprimer dans le centre d’origine parmi des allèles qualifiés de dominants. La récessivité renvoie au fait qu’un allèle présent dans le patrimoine génétique d’un individu ne s’exprime pas au niveau de son phénotype. Dans cette vision, ces allèles récessifs ne s’expriment que dans des conditions particulières, notamment lorsqu’un individu possède les deux versions du même gène sous cette forme récessive. En prenant l’exemple d’allèles humains (une peau claire étant récessive et une peau sombre dominante) et en l’appliquant dans un cadre racialiste (la peau claire étant un caractère considéré comme « supérieur »), Vavilov imagine un mécanisme d’amélioration des espèces. Il estime en effet qu’en éliminant les allèles dominants, on peut permettre aux allèles qualifiés de « meilleurs » de s’exprimer. Cette théorie et le phénomène de collecte mondiale des gènes constituent ainsi le support d’un projet impérialiste et eugéniste de contrôle des ressources biologiques et naturelles par une race autoproclamée comme supérieure, portant des gènes récessifs.
20e siècle : le gène comme objet global de savoirs et de pouvoirs
La transition de cette conception à celle de la diversité biologique comme un capital d’intérêt mondial s’est faite au moyen de métaphores politiques, économiques et financières extractivistes pour désigner les organismes vivants. En particulier, en 1926, Aleksandr Serebrovsky de l’institut de biologie expérimentale de Moscou développe cette analogie avec les industries minières en mobilisant le terme de genofond, littéralement un fond de gènes à disposition et qui attendraient d’être optimisés par des politiques eugéniques — avec dans l’idée de créer un être humain soviétique supérieur. Le terme de genofond se répand, la génétique s’internationalise, et, à la fin des années 1930, la catégorie de ressources génétiques est stable et le gène est bien un objet global de savoirs et de pouvoirs.
Les deux décennies suivantes voient des initiatives de collecte de ressources végétales et l’établissement de premières collections d’espèces cultivées et sauvages (blé, orge, tournesol, lentilles, pomme de terre) se multiplier dans plusieurs pays, notamment l’URSS, l’Allemagne et les États-Unis. Ces derniers développent une stratégie similaire à celle de l’URSS au début des années 1920 de modernisation biopolitique, ancrant le rôle de l’État dans les domaines de l’élevage et de la génétique et dans la sécurisation des banques de gènes face aux menaces que font peser les changements économiques. Cette stratégie repose elle aussi sur des expéditions planétaires et sur une compétition internationale à propos du plasma germinatif des espèces (= l’ensemble des ressources génétiques exploitables d’une plante ou d’un animal). Les gènes se constituent alors en objets géopolitiques, sujets de compétitions et de pillage nazi pendant la Seconde Guerre mondiale.
La période de l’entre-deux-guerres est cependant celle d’initiatives internationales de conservation des ressources génétiques, notamment des races locales, dans le contexte de politiques internationales sur les matières premières de la Ligue des Nations. Par exemple, l’International Association of Plant Breeder est fondée en 1927, dont la mission est de protéger les droits des sélectionneurs de plantes en reconnaissant légalement leurs nouvelles variétés, en définissant des conditions d’usage et de licence des semences, et en posant les bases d’une législation internationale. Ses membres proviennent de 30 pays différents. Une tension se retrouve entre une stratégie de conservation des races cosmopolite et centralisée (qui correspondra plus tard à une posture de conservation ex situ) et une stratégie reposant sur des savoirs locaux (conservation in situ). L’avantage est pris par les généticiens cosmopolites : entre 1933 et 1945, il y a une domination des collections centralisées et d’expéditions impérialistes en quête de gènes.
Les cultures comme ressources génétiques : une vision moderne du vivant
Selon l’auteur de la publication, l’histoire de la collection des ressources génétiques est ainsi indissociable de celle de l’industrialisation de l’agriculture. Cette intrication prend racine dans la période s’étendant entre 1890 et 1940 et dans la concomitance de l’émergence de la catégorie de ressource génétique et de l’écologie mondiale fossile et impérialiste. La gestion de la diversité des cultures en tant que ressources génétiques au cours des premières décennies du 20e siècle contient en elle un récit, une interprétation du monde : la cosmovision moderne. Elle peut être saisie dans la façon dont les objets scientifiques et techniques, leur définition et leur environnement social et écologique sont liés. Ce récit, concernant les ressources génétiques, peut être délié en cinq éléments.
- Le premier a trait à une conception des plantes comme des machines, comme des assemblages de caractéristiques, de briques élémentaires déterminées par des gènes et qui ont besoin d’être optimisées pour répondre aux ambitions étatiques de modernisation de l’agriculture. La modernisation de l’agriculture et la collecte et conservation des gènes partagent la même volonté de contrôle des briques provenant d’un passé lointain pour construire une culture moderne ; la standardisation des paysages génétiques et la collection globalisée des gènes vont de pair.
- Cette vision définit la diversité biologique des cultures comme une collection d’unités statiques et anhistoriques, ignorant son contexte historique, ses origines et ses évolutions passées, plutôt que des processus écologiques et de cultures complexes. Le deuxième élément tient dans l’oubli, au début du 20e siècle, de la vision historique et dynamique que Darwin proposait de la variation génétique. Au lieu de considérer la co-évolution permanente des gènes, des cultures et de leurs environnements socio-écologiques, c’est une vision d’un héritage ancien et maintenant stabilisé que l’on peut mettre au profit d’une production de masse standardisée qui est portée. La métaphore extractiviste incarne une distinction entre une nature statique et un homme moderne blanc qui dicte son mouvement au monde. Cette posture donne de l’autorité au scientifique, une légitimité au projet industriel de rendre les sociétés paysannes gouvernables par l’homogénéisation et de dépasser les lois de la nature.
- Le troisième élément concerne la supposition que les variétés locales seraient décimées par la supériorité des variétés sélectionnées ou hybridées (appelées cultivars). Ces récits sont remis en question par des observations contradictoires, notamment pour les cas du maïs au Mexique ou pour les pommes de terre au Pérou, pour lesquels la diversité génétique a été préservée malgré la modernisation. Le récit de la nécessité de la modernité qui s’accompagne d’une perte de diversité inéluctable et l’invocation des générations futures guide et légitime ainsi la toute-puissance de la révolution verte, cette transformation du monde agricole dans les années 1960 utilisant des variétés à haut rendement, des engrais, des pesticides et une irrigation intensive.
- Quatrièmement, la catégorie de ressource génétique a contribué à co-produire un nouveau type de savoir global et un objet géopolitique. Elle permet en effet de présenter à la fois les gènes comme des ressources globales et les races locales comme des objets locaux. Localiser ainsi la diversité rend possibles l’extraction d’objets (les gènes, les cultivars enregistrés) pouvant être régulés à l’échelle globale et le passage de sociétés paysannes fondées sur les communs à un matériel génétique construit comme une richesse publique plutôt que des variations qui s’expérimentent localement. Ce discours opère ainsi une double globalisation : à la fois des ressources génétiques et de l’humanité dans son ensemble.
- Le dernier élément réside dans la faible capacité d’action attribuée aux cultivateurs dans la culture et le maintien de la diversité : les modernes décrivent la diversité comme ayant été jusqu’alors naturelle ou le résultat de pratiques inconscientes, hasardeuses, alors que les travaux d’anthropologie montrent que les communautés paysannes ont joué un grand rôle dans le façonnement des savoirs et du maintien de cette diversité. Tout se passe comme si les anciennes races locales étaient du côté de la nature et que les cultivars génétiquement améliorés logeaient du côté de la culture.
La notion de ressource génétique traduit ainsi des manières nouvelles de concevoir le vivant. Elle révèle des récits et des rapports entre savoirs et pouvoir contenus dans la modernisation génétique. En particulier, elle incarne des clivages entre nature et culture, entre une immobilité ancienne et une mobilité moderne, ou encore entre des biens communs locaux voués au gaspillage ou à l’extinction et un bien public mondial à gérer.
Les limites de la standardisation du vivant : la question de l’échelle et contestations paysannes
Ce qui est scalable pourrait se définir comme la qualité de certains objets à pouvoir changer d’échelle sans changer de nature [2]. Dans le cas de la sélection génétique des plantes, on peut se poser la question de la scalabilité. Par exemple : une variété de maïs adaptée à un terroir spécifique ne donnera pas les mêmes résultats si elle est cultivée ailleurs. Elle change de nature en changeant d’échelle. Cela est particulièrement apparent lorsque l’on prend en considération le fait que les procédés de standardisation et ceux d’universalisation des produits, des modes de consommation et des modes de production dépossèdent les espèces végétales des savoirs locaux qui les ont façonnées et plus généralement de leurs conditionnements socio-écologiques. Des banques de gènes pourraient ne pas suffire à restituer la richesse des espèces qu’ils codent.
Des mouvements politiques contemporains s’emparent précisément de cette question. En particulier, elle fait échos au Réseau de Semences Paysannes qui a vu le jour en 2003 et qui revendique « le droit pour les agriculteurs de cultiver et d’échanger des semences de variétés non inscrites au Catalogue officiel des Obtentions Végétales » [3]. Plus précisément, ce Réseau s’inscrit dans la tradition des communs valorisant non seulement les semences paysannes mais également le monde, c’est-à-dire la communauté, les valeurs et les savoirs qui les accompagnent, et souligne qu’il existe une ontologie alternative des semences [4]. En mettant l’accent sur les semences comme étant issues d’une coévolution entre les pratiques humaines, les plantes et les territoires, un tel mouvement réhabilite ce que la tentative de rendre des semences scalables peut faire perdre de vue.
[*] Selon les lois de Mendel, les caractères hérités des parents se répartissent dans la descendance selon des proportions mathématiquement prévisibles, car les gènes responsables de ces traits sont transmis séparément les uns des autres.
[1] Quattrocchio F., et al., Molecular Analysis of the anthocyanin2 Gene of Petunia and Its Role in the Evolution of Flower Color. The Plant Cell, 1999. DOI : 10.1105/tpc.11.8.14335 [Publication scientifique]
[2] Tsing AL., On Nonscalability: The Living World Is Not Amenable to Precision-Nested Scales. Common Knowledge, 2019. DOI : 10.1215/0961754X-7299210 [Publication scientifique]
[3] Demeulenaere E. & Bonneuil C., Des Semences en partage. Techniques & Culture, 2011. DOI : 10.4000/tc.5902 [Article]
[4] Demeulenaere E., A political ontology of seeds: The transformative frictions of a farmers’ movement in Europe. Focaal, 2014. DOI : 10.3167/fcl.2014.690104 [Publication scientifique]